Siège de Massada
Sur les bords de la Mer Morte, les ruines d'une forteresse antique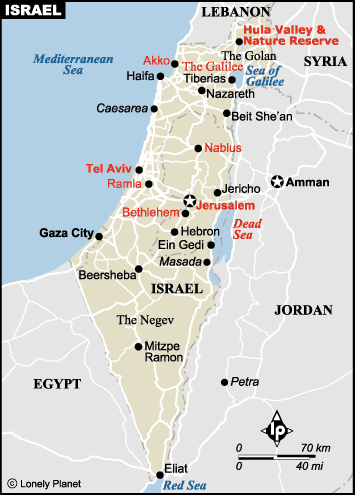 surveillent la plaine environnante. Après le Mur des Lamentations à Jérusalem, la forteresse de Massada est le deuxième site le plus visité d’Israël. La raison en est qu’elle représente un puissant symbole de l’histoire des Juifs, et particulièrement au Ier siècle de notre ère, durant ce que l’on nomme la Grande Révolte des Juifs contre l’Empire romain. En 66, suite au massacre de Juifs par des soldats romains dans la ville portuaire de Césarée, des soulèvements se multiplient dans la province romaine de Judée et atteignent Jérusalem. La révolte prend forme et se diffuse à toutes les cités de la province de Judée. Mais elle est de courte durée. En 70, après un siège de plusieurs mois, Jérusalem tombe aux mains des Romains ce qui marque la fin de la révolte. Pourtant, comme pour nos amis gaulois, il existait encore un bastion qui résistait à l’envahisseur, Massada. Une faction dissidente, les sicaires, s’y est réfugiée dès 66 et tient tête aux Romains. Mais la résistance est vaine puisqu'en 73 les Romains conquièrent la forteresse. Si Massada garde une place importante dans les esprits et l'histoire des Juifs, ce n’est pas par sa résistance mais par le désir de liberté des sicaires. Face à l'envahisseur, les habitants de Massada se sont battus jusqu'au bout pour leur liberté. Un combat pour la survie des leurs et de leur religion.
surveillent la plaine environnante. Après le Mur des Lamentations à Jérusalem, la forteresse de Massada est le deuxième site le plus visité d’Israël. La raison en est qu’elle représente un puissant symbole de l’histoire des Juifs, et particulièrement au Ier siècle de notre ère, durant ce que l’on nomme la Grande Révolte des Juifs contre l’Empire romain. En 66, suite au massacre de Juifs par des soldats romains dans la ville portuaire de Césarée, des soulèvements se multiplient dans la province romaine de Judée et atteignent Jérusalem. La révolte prend forme et se diffuse à toutes les cités de la province de Judée. Mais elle est de courte durée. En 70, après un siège de plusieurs mois, Jérusalem tombe aux mains des Romains ce qui marque la fin de la révolte. Pourtant, comme pour nos amis gaulois, il existait encore un bastion qui résistait à l’envahisseur, Massada. Une faction dissidente, les sicaires, s’y est réfugiée dès 66 et tient tête aux Romains. Mais la résistance est vaine puisqu'en 73 les Romains conquièrent la forteresse. Si Massada garde une place importante dans les esprits et l'histoire des Juifs, ce n’est pas par sa résistance mais par le désir de liberté des sicaires. Face à l'envahisseur, les habitants de Massada se sont battus jusqu'au bout pour leur liberté. Un combat pour la survie des leurs et de leur religion.

Une histoire racontée, le rôle de son conteur Flavius Josèphe
Si, aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de Massada, c'est grâce au récit de Flavius Josèphe (portrait ci-contre). Historien juif écrivant en grec pour un public romain et juif, il retrace l'histoire de la Grande Révolte à travers un ensemble de trois ouvrages : La Guerre des Juifs (rédigée entre 75 et 79), Les Antiquités judaïques (93) et son autobiographie aux alentours de 100.  Flavius Josèphe est contemporain des événements et a directement participé à la guerre. Malgré ses réticences à entrer dans le conflit, les révoltés le persuadent en 66 de devenir le gouverneur de la province de Galilée pour lutter contre les Romains. Il est cependant défait par le général romain Vespasien en 67 au cours du siège de Jotapata (actuel Yotpata). Avec un autre homme, ils sont les seuls survivants. Il tente de sauver sa vie auprès de Vespasien et de son fils Titus en prophétisant que Vespasien serait le prochain empereur. Après la mort de Néron en 68 et les troubles de succession l'année suivante où 3 empereurs se sont succédé, Vespasien parvient effectivement sur le trône impérial. Pour le remercier, il fait de Flavius Josèphe son interprète durant ses campagnes. Ce dernier est cependant disgracié par les Juifs qui voient en lui un traitre à la cause juive. Ils ne l'écoutent pas durant le siège de Jérusalem en 70 lorsque ce dernier leur dit qu'il est vain de lutter contre la puissance de Rome. Une fois la révolte terminée, il repart à Rome avec Vespasien et débute le récit de la guerre. Grâce aux retours des soldats, il relate le siège de Massada dans son premier ouvrage, La Guerre des Juifs. Flavius Josèphe est un auteur incontournable en ce qui concerne l'histoire des Juifs car il est le seul auteur non-chrétien à traiter ce sujet. Mais un parti pris clairement affirmé durant son récit nécessite une extrême précaution durant l'étude de ses textes.
Flavius Josèphe est contemporain des événements et a directement participé à la guerre. Malgré ses réticences à entrer dans le conflit, les révoltés le persuadent en 66 de devenir le gouverneur de la province de Galilée pour lutter contre les Romains. Il est cependant défait par le général romain Vespasien en 67 au cours du siège de Jotapata (actuel Yotpata). Avec un autre homme, ils sont les seuls survivants. Il tente de sauver sa vie auprès de Vespasien et de son fils Titus en prophétisant que Vespasien serait le prochain empereur. Après la mort de Néron en 68 et les troubles de succession l'année suivante où 3 empereurs se sont succédé, Vespasien parvient effectivement sur le trône impérial. Pour le remercier, il fait de Flavius Josèphe son interprète durant ses campagnes. Ce dernier est cependant disgracié par les Juifs qui voient en lui un traitre à la cause juive. Ils ne l'écoutent pas durant le siège de Jérusalem en 70 lorsque ce dernier leur dit qu'il est vain de lutter contre la puissance de Rome. Une fois la révolte terminée, il repart à Rome avec Vespasien et débute le récit de la guerre. Grâce aux retours des soldats, il relate le siège de Massada dans son premier ouvrage, La Guerre des Juifs. Flavius Josèphe est un auteur incontournable en ce qui concerne l'histoire des Juifs car il est le seul auteur non-chrétien à traiter ce sujet. Mais un parti pris clairement affirmé durant son récit nécessite une extrême précaution durant l'étude de ses textes.
Aux origines du siège, la Grande Révolte juive (66 - 70)
Lorsque la Grande Révolte éclate en 66, la présence romaine en Palestine dure déjà depuis un siècle. 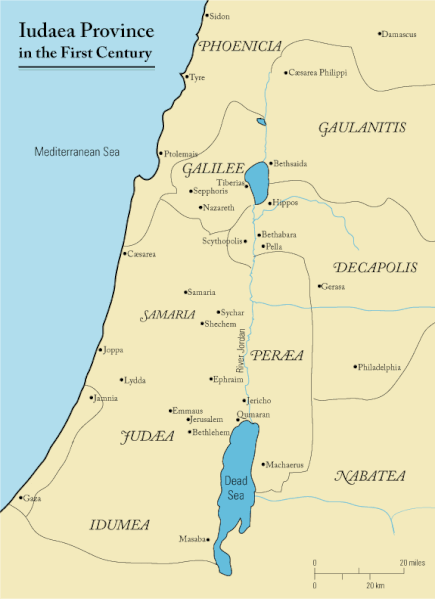 En effet, c'est grâce à Pompée et à sa victoire contre Mithridate VI Eupator, souverain du Pont (un empire entourant la mer Noire et comprenant la Turquie actuelle). La Syrie devient alors une province romaine et la région de la Judée un client de Rome lorsque Hérode arrive au pouvoir en 37 avant J.-C. En 6 apr J.-C, la province de Judée est constituée. Afin de gouverner au mieux ce territoire, l'empereur de Rome envoie un procurateur (un gouverneur) sur place et agit au nom de l'empereur. Des tensions existent entre les deux peuples, notamment les exactions contre les Juifs au début du siècle. Mais la révolte prend naissance à Césarée, une ville portuaire, où les Romains, sans doute pour narguer les Juifs, sacrifie un oiseau devant la synagogue ce qui rend le monument impur. Les escarmouches entre Juifs et Romains se multiplient et atteignent la capitale provinciale. À Jérusalem, le procurateur Gessius Florus profite des troubles pour s'emparer de 17 talents d'argents (une unité de masse : 1 talent ≈ 30 kg) dans le trésor du Temple, haut lieu sacré du judaïsme. Monument central de la communauté juive, c'en est trop pour les Juifs et ils calomnient le procurateur qui envoie ses troupes. Le sang coule de chaque côté et Florus s'enfuie à Césarée.
En effet, c'est grâce à Pompée et à sa victoire contre Mithridate VI Eupator, souverain du Pont (un empire entourant la mer Noire et comprenant la Turquie actuelle). La Syrie devient alors une province romaine et la région de la Judée un client de Rome lorsque Hérode arrive au pouvoir en 37 avant J.-C. En 6 apr J.-C, la province de Judée est constituée. Afin de gouverner au mieux ce territoire, l'empereur de Rome envoie un procurateur (un gouverneur) sur place et agit au nom de l'empereur. Des tensions existent entre les deux peuples, notamment les exactions contre les Juifs au début du siècle. Mais la révolte prend naissance à Césarée, une ville portuaire, où les Romains, sans doute pour narguer les Juifs, sacrifie un oiseau devant la synagogue ce qui rend le monument impur. Les escarmouches entre Juifs et Romains se multiplient et atteignent la capitale provinciale. À Jérusalem, le procurateur Gessius Florus profite des troubles pour s'emparer de 17 talents d'argents (une unité de masse : 1 talent ≈ 30 kg) dans le trésor du Temple, haut lieu sacré du judaïsme. Monument central de la communauté juive, c'en est trop pour les Juifs et ils calomnient le procurateur qui envoie ses troupes. Le sang coule de chaque côté et Florus s'enfuie à Césarée.
Au cœur de la mêlée, certains groupuscules juifs voient le jour, les Zélotes et les Sicaires. Les premiers sont des fanatiques et croient en une action divine qui délivrera les Juifs des persécuteurs romains et sont prêts à divers actes de propagandes pour y arriver. Les Sicaires, eux, sont encore plus extrêmes que les Zélotes. Caché sous leur tunique, il porte à la ceinture une dague, sica ce qui leur donne leur nom. Eux-mêmes cachés dans la foule, ils se faufilent derrière les gardes, les personnalités romaines et les partisans pro-romains pour les assassinés. D'après Mireille Habas-Lebel, on peut même parler de terrorisme à cette échelle. Ils sèment la terreur à Jérusalem. Tout ceci pour libérer la Judée de l'emprise romaine.
Toujours en 66, fuyant les exactions romaines, un petit groupe de Sicaires font le voyage jusqu'à Massada. Ils tuent tous les résidents et prennent leur place dans la forteresse. Lorsque le gouverneur de Syrie arrive avec la XIIe Légion, les résistants juifs réussissent à défaire cette force punitive et installent une nouvelle administration en Judée. Elle est alors divisée en plusieurs circonscriptions. Notre narrateur, malgré sa réticence à entrer en guerre contre une armée bien supérieure, décide de prendre les armes et de diriger la résistance en Galillée. Cependant, Néron décide de reprendre ce qui lui appartient et envoie Vespasien, général romain et membre important du patriciat romain. Avec lui se trouve son fils Titus qui jouera un rôle essentiel plus tard. Vespasien arrive avec trois légions et part à la conquête de la Galilée. Flavius Josèphe se retranche dans la forteresse de Jotapata (Yotpata). Après un long de siège de plusieurs semaines, la forteresse est prise et par miracle, Flavius Josèphe et l’un des deux seuls survivants. Il est alors emprisonné.
Vespasien continue ensuite la reconquête des terres judéennes. Mais un événement vient chambouler la situation politique romaine. Néron meurt en 68 et une période de troubles appelée l’année des quatre empereurs. Comme l’énonce le nom, quatre empereurs se sont succédés au cours d’une seule année et à la fin il n’en resta qu’un, Vespasien, élu par ses troupes comme nouvel empereur. Nous sommes maintenant en 69 et la quasi-totalité de la Judée est sous domination romaine. Il ne reste que quelques places fortes et bien évidemment, la capitale Jérusalem. Au printemps 70, la ville est assiégée. Titus fait encercler la ville empêchant toute personne de sortir sous peine de crucifixion. Il laisse les pèlerins entrer afin de surpeupler la ville et ainsi les pousser à la sortie le plus vite possible. Après plusieurs mois de siège, les Hiérosolymites (habitants de Jérusalem) sont épuisés, Josèphe rapporte le cas d’une femme si désespérée qu’elle a mangé son enfant nourrisson pour survivre. En septembre 70, la ville est finalement prise et avec cela tout un cycle de massacres et de pillages. Le Temple, bâtiment sacrée du culte juif est détruit. Il ne reste alors qu’un mur qui devient le Mur des lamentations. On tue à tout va, hommes, femmes et enfants malgré la recherche d’esclaves qui étaient la politique des Romains. Les morts se comptent en centaines de milliers. Cependant, certains arrivent à fuir les massacres et une partie va se réfugier dans le dernier bastion encore libre de Judée, Massada.

Bas-relief présent sur l'Arc de Titus. On peut y voir le pillage du temple de Salomon à Jérusalem.
Massada ou la dernière étincelle de la résistance
La forteresse de Massada (qui en hébreu veut dire forteresse ou refuge) est nichée à plus de 400 m de haut et surplombe la mer Morte. On n'a pas de date précise du début de sa construction. Des théories suggèrent que les travaux ont débuté au cours du IIe siècle avant J.-C. Sa première construction n'accueillait cependant qu'une petite garnison. Ce n'est que sous le règne du roi Hérode le Grand (73 – 4 avant J.-C) que la forteresse subit de nombreux travaux et ressemble à ce que les touristes peuvent visiter aujourd'hui. Le camp est fortifié avec des murs de plus de 5 mètres de haut, d'une épaisse de 3,7 m. L'enceinte de 1 300 mètres voit se succéder 37 tours de 22 mètres de haut pour améliorer la défense de la forteresse. De nos jours, certains historiens parlent d'un nid d'aigle en référence à Berchtesgaden dans les montagnes autrichiennes. Un site qui pouvaient grâce aux aménagements d'Hérode le Grand soutenir un siège grâce à des entrepôts, des fours et surtout des citernes qui captaient l'eau de pluie lorsque les fortes averses tombées en Judée. Grâce à la gravité et à des canaux d'irrigation, l'eau était emmagasinée dans des citernes un peu plus bas dans la falaise et remontée par des mulets jusqu'à la forteresse.
Au sein de cette forteresse ont trouvé refuge, toujours d'après Flavius Josèphe, 967 Juifs dès le début de la révolte en 66. Parmi ceux-ci, les sicaires, les plus zélés, encouragent les survivants à combattre les Romains jusqu'au dernier. Préférer la mort à la servitude était devenu le mot d’ordre de la population de Massada. Après la révolte, les Romains continuent de soumettre la province et Massada devient rapidment le dernier bastion de résistance. Le général romain Lucius Flavius Silva est envoyé en Judée en 71 à la tête de trois légions afin d'anéantir une bonne fois pour toutes la résistance de Massada. Après deux ans de campagne, il arrive finalement aux pieds de celle-ci.
Massada est un site stratégiquement construit. Elle surplombe la plaine en haut d'un promontoire et il n’existe qu’une seule route praticable pour s'y rendre. Elle est donc facilement défendable. Elle possède des murailles de près de cinq mètres de haut auxquelles s'ajoutent 37 tours où peuvent se poster des archers. Le siège s’annonce long et les Romains font le choix d'un siège d'usure. En effet, Silva ne veut pas perdre inutilement des hommes dans ce siège et cherche également à faire des rescapés des esclaves. Il est donc dans son intérêt qu’un maximum d’individus survive. Cependant, les entrepôts de Massada sont pleins et le système d’irrigation qui date d’Hérode le Grand (Ier siècle av J.-C.) achemine l’eau vers les citernes. Respectant les manuels militaires, les Romains entament la construction d'une enceinte autour de la citadelle afin de bloquer toute tentative de fuite et empêcher également l’arrivée de renfort. Un mur de trois kilomètres de long est élevé ainsi qu’un camp militaire d’où les Romains construisent des engins de siège, reprenant ici le schéma de César à Alésia. 8 000 légionnaires y sont rassemblés ainsi qu'une immense population d’esclaves dont une bonne partie de Juifs.
À cause de sa situation géographique Massada n’est accessible que par les faces est et ouest. Cependant, la face orientale est très escarpée et peu praticable. La face occidentale est plus abordable mais aussi mieux défendue que le reste. C’est là que se concentrent les offensives romaines appuyés par des onagres (des catapultes) et des tours de siège. Mais les assiégés tiennent bon. Lorsque les murs subissent des dégâts ils sont renforcés par des poutres. Flavius Silva voyant que les vivres de la forteresse tiendront plus longtemps que les siennes prend la décision étonnante de faire construire une rampe entre son camp et le versant occidental. Pendant sept mois, les esclaves ont assemblé des centaines de tonnes de terres pour combler les 400 mètres de falaise. Une fois l’édifice terminé, aidé par une tour de siège, Flavius fait l’ascension de la rampe et arrive aux murailles de Massada. À sa grande surprise, il ne trouve personne. Il n'y a pas une âme qui vive mais une mer de cadavres dans les rues de la citadelle. Tous les résidents sont morts au cours d’un suicide collectif orchestré par les sicaires. En effet, apercevant la rampe s’élever un peu plus tous les jours, les Juifs voyaient leur espoir de survie s’éloigner. Contrairement aux légionnaires, les rescapés juifs ne sont pas des combattants. On y trouve des femmes, des enfants et des vieillards. Si les Romains réussissent à pénétrer les murailles, ce serait la fin de leur liberté. Les plus fanatisés, les sicaires, déclarent qu’il est préférable de se suicider et mourir libre plutôt que vivre dans la servitude des Romains. Face à une situation désespérée et à la persuasion des plus extrêmes, tout le monde est convaincu que c’est la bonne action à suivre. Toutefois, si l’on suit la loi judaïque, le suicide est interdit et le meurtre est un crime mortel. Il est également précisé que les Juifs doivent tout faire pour préserver leur vie et pour eux la servitude n’est plus une vie. Le chef de la citadelle, Eléazar, décide de la procédure à suivre. Les chefs de familles doivent tuer leur femme et leurs enfants et des personnes désignées les tuent à leur tour. C'est un cycle sans fin jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne qui doit se donner la mort. Sur les 967 habitants, les Romains dénombrent 960 cadavres. Deux femmes et cinq enfants s'étaient en effet réfugiés dans les grottes. On y trouve notamment une parente d'Eléazar qui relatera les événements à Flavius Josèphe. Les Romains sont stupéfaits devant tant de dévotions envers leurs idéaux. Pour marquer leur insoumission, les derniers Juifs ont incendié le palais d'Hérode et brûler les richesses en préservant les vivres montrant ainsi que ce n'était pas par désespoir qu'ils se sont donnés la mort mais pour préserver leur liberté.
s’élever un peu plus tous les jours, les Juifs voyaient leur espoir de survie s’éloigner. Contrairement aux légionnaires, les rescapés juifs ne sont pas des combattants. On y trouve des femmes, des enfants et des vieillards. Si les Romains réussissent à pénétrer les murailles, ce serait la fin de leur liberté. Les plus fanatisés, les sicaires, déclarent qu’il est préférable de se suicider et mourir libre plutôt que vivre dans la servitude des Romains. Face à une situation désespérée et à la persuasion des plus extrêmes, tout le monde est convaincu que c’est la bonne action à suivre. Toutefois, si l’on suit la loi judaïque, le suicide est interdit et le meurtre est un crime mortel. Il est également précisé que les Juifs doivent tout faire pour préserver leur vie et pour eux la servitude n’est plus une vie. Le chef de la citadelle, Eléazar, décide de la procédure à suivre. Les chefs de familles doivent tuer leur femme et leurs enfants et des personnes désignées les tuent à leur tour. C'est un cycle sans fin jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne qui doit se donner la mort. Sur les 967 habitants, les Romains dénombrent 960 cadavres. Deux femmes et cinq enfants s'étaient en effet réfugiés dans les grottes. On y trouve notamment une parente d'Eléazar qui relatera les événements à Flavius Josèphe. Les Romains sont stupéfaits devant tant de dévotions envers leurs idéaux. Pour marquer leur insoumission, les derniers Juifs ont incendié le palais d'Hérode et brûler les richesses en préservant les vivres montrant ainsi que ce n'était pas par désespoir qu'ils se sont donnés la mort mais pour préserver leur liberté.
Conclusion et conséquences
Le dernier bastion des Juifs en Judée vient de tomber. Les Romains sont maîtres de la région et de sa population. Une bonne partie de celle-ci est rendue en esclavage et les survivants sont éparpillés dans tout l'empire. A la fin de la guerre, il ne reste plus de Juif en terre de Judée. La "Terre promise" a été perdue. C'est à ce moment que se crée la diaspora juive tout autour de la mer Méditerranée.
A Rome, les richesses que les Romains ont pu acquérir avec le pillage du Temple de Jérusalem ont permis la construction du Colisée et l'embellissement de la ville.
La forteresse de Massada est ensuite investie par quelques religieux dans les années qui suivent puis elle est délaissée par ses voisins. Elle prend le nom de Sebbeh et se perd dans les mémoires. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que l'on retrouve une trace de l'antique cité. Le récit qu'a fait Flavius Josèphe de la Grande Révolte a parcouru les âges et était devenu un véritable best-seller au XVIe siècle. Voulant trouver Massada, des auteurs et des scientifiques font route vers l'Orient comme François-René de Chateaubriand et Alphonse de Lamartine. C'est finalement un missionnaire anglais, S.W. Wolcott qui, se basant sur son prédécesseur Edward Robinson qui avait aperçu depuis les rives de la mer Morte des traces de construction et qui les avait retranscrites dans un rapport de voyage en 1841, pose, le premier, le pied dans la forteresse de Massada en 1842.
S'ensuit alors toute une série d'expéditions scientifiques ayant pour but la vérification du récit de Flavius Josèphe et l'approfondissement des connaissances sur cet épisode. L'attention portée est si grande qu'un siècle et demi plus tard, en 2001, la forteresse est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Se basant sur cette histoire d 'une forteresse qui a été le dernier rempart contre l'envahisseur, l'État d'Israël a développé le "complexe de Massada". Il s'agit d'un état d'esprit dans lequel Israël serait entouré d'ennemi comme l'a été Massada et qu'elle doit lutter jusqu'à son dernier souffle pour ne pas être anéantie et tout comme elle Israël serait aussi le dernier refuge pour les Juifs. De même, Massada est aujourd'hui pleinement intégrée dans les consciences et les soldats de Tsahal, l'armée d'Israël, y viennent prêter serment par ces mots : "Massada ne tombera pas une nouvelle fois". Les officiers s'y rendent également lorsqu'ils terminent leur formation. Le site de Massada est le lieu d'exercices d'endurance par équipe afin de forger la camaraderie des futurs soldats. Une analogie peut être faite avec le souvenir d'Alamo au Texas face aux troupes d'invasion du président mexicain Santa Anna au XIXe siècle: "Remember the Alamo".
'une forteresse qui a été le dernier rempart contre l'envahisseur, l'État d'Israël a développé le "complexe de Massada". Il s'agit d'un état d'esprit dans lequel Israël serait entouré d'ennemi comme l'a été Massada et qu'elle doit lutter jusqu'à son dernier souffle pour ne pas être anéantie et tout comme elle Israël serait aussi le dernier refuge pour les Juifs. De même, Massada est aujourd'hui pleinement intégrée dans les consciences et les soldats de Tsahal, l'armée d'Israël, y viennent prêter serment par ces mots : "Massada ne tombera pas une nouvelle fois". Les officiers s'y rendent également lorsqu'ils terminent leur formation. Le site de Massada est le lieu d'exercices d'endurance par équipe afin de forger la camaraderie des futurs soldats. Une analogie peut être faite avec le souvenir d'Alamo au Texas face aux troupes d'invasion du président mexicain Santa Anna au XIXe siècle: "Remember the Alamo".
Plus qu'une défaite juive contre les Romains, Massade incarne un idéal de dévotion d'une minorité de la population contre le pouvoir de l'empire romain. Jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière femme, ces Juifs de Massada ont tenu tête à un ennemi supérieur. C'est une victoire parmi tant d'autres pour les Romains, mais, pour les Juifs elle devient un élément identitaire fort. Plus qu'un simple affrontement, Massada est aussi le symbole des tensions qui existent entre le peuple juif et les Romains dont les relations sont rythmées de périodes de paix et d'affrontements.
Publié par Adrien RASATA le 13 février 2021
Sources et bibliographie
Ouvrages et articles :
- Habas-Lebel Mireille. « Sicaires et Zélotes, rebelles nationalistes ou « assassins pieux » », Le Temps des médias, vol. 32, no. 1, 2019, pp. 23-33.
- Habas-Lebel Mireille, Massada : Histoire et symbole, Albin Michel, 2014, 176 p (utilisation du prologue pour l’historique de la découverte du site).
- Josèphe Flavius, Guerre des Juifs, livre VII (la prise de Massada).
- Vidal-Naquet Pierre. « Pour ouvrir le bal », Hypothèses, vol. 4, no. 1, 2001, pp. 250-255.
- L’Express [en ligne]. Louyot Alain, 22/08/2002 [consulté le 27 juillet 2019], La forteresse du sionisme. Disponible sur :
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/la-forteresse-du-sionisme_498215.html
Vidéos :
- À l’origine, Berechit – Derrière les portes, Massada la forteresse assiégée, France 2, Émission du 21 juillet 2019
LA « GUERRE DES JUIFS » vesves LA CHUTE DE MASSADA (66 74 AP. J. C.) | 2000 ANS D’HISTOIRE | FR, par France Inter, disponible sur la chaïne Vanesa Glaude depuis le 16 janvier 2018 [visionnée le 13 février 2021] . Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=NjR_Vs_qRrk - La guerre des Juifs. Rome contre Jérusalem, Arte, Emission du 13 avril 2019
Crédits photos :
1) Localisation de Massada en Israël. Disponible sur : http://ravaut.fr/2010/08/13/massada-mer-morte-houmous-et-vide-grenier-par-fred/
2) La conquista de Massada. Auteur inconnu. Disponible sur : https://revistadehistoria.es/la-conquista-de-masada/
3) Photographie d'un buste de Flavius Josèphe représentée dans un exemplaire de la Guerre des Juifs en anglais de 1888. Disponible sur : https://commons.wikimedia.or /wiki/File:Josephusbust.jpg
4) Carte de la Judée créée par Andrew C en 2006 sur la page anglaise de la province romaine de Judée. Disponible sur : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_century_Iudaea_province.gif
5) Bas relief de l'arc de triomphe de Titus à Rome. Disponible sur : https://www.jforum.fr/jerusalem-destruction-de-la-ville-et-du-temple-6-6-video.html
6) Plan schématique de la forteresse de Massada. Auteur inconnu. Disponible sur : https://www.pinterest.com/pin/553590979175714408/
7) Rampe romaine durant le siège de Massada. Auteur inconnu. Disponible sur : https://peashooter85.tumblr.com/post/138313290357/the-siege-of-masada-in-66-ad-a-large-jewish
8) Marche de soldats israéliens entamant l'ascension de Massada. Auteur inconnu. Disponible sur : https://www.flickr.com/photos/45644610@N03/10020496203
Ajouter un commentaire

